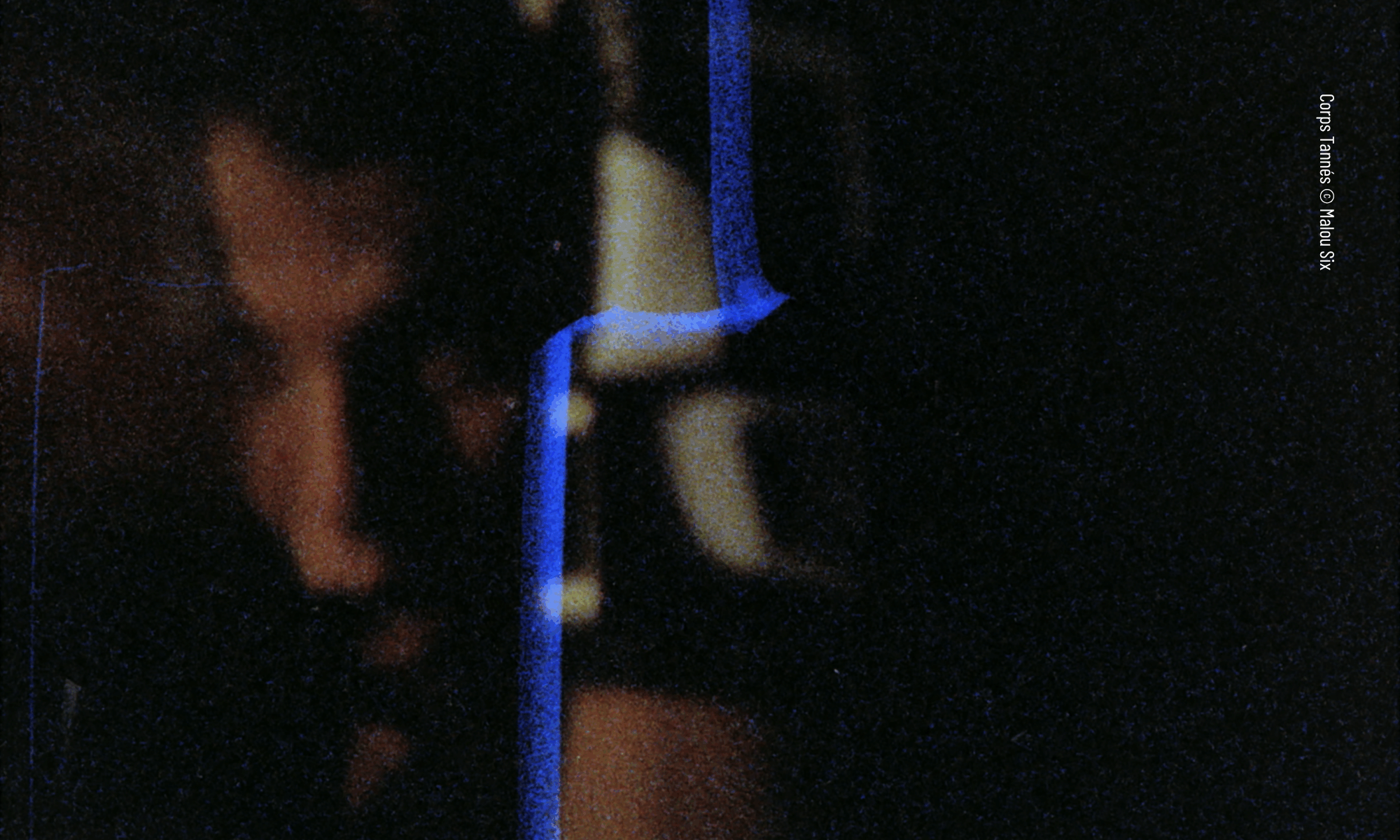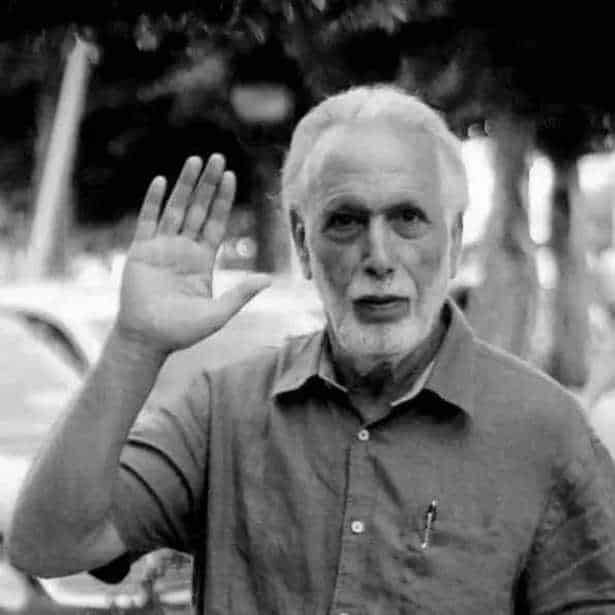Journaliste et critique tunisien, Khémaïs Khayati vient de publier chez L’Harmattan,
Le cinéma documentaire arabe
Quelques réflexions sur un sujet en agonie
Comme partout ailleurs, c’est Lumière qui a précédé Méliès dans l’introduction du cinéma dans les pays arabes. En Egypte — à titre d’exemple — bien avant Layla, le film de fiction de Widad Orfi et Stéphane Rosty (1927), des essais documentaires furent réalisés dès 1907 par les photographes alexandrins Doris et Aziz. Dans les années 20, le financier Talaat Harb
affirmait sa volonté de fonder un cinéma qui soit d’abord documentaire : destiné à l’enregistrement des activités sociales et industrielles égyptiennes. Ces films devaient assurer leur promotion dans les pays voisins, « au profit d’une culture commune et d’intérêts commerciaux partagés”.
Cet intérêt, louable en soi, marqua le cinéma documentaire du sceau du « droit de regard de l’État ». Il ne put s’en défaire que vers la décennie 60-70, précisément après la défaite de 1967 (Guerre des six jours). Organiquement lié au politique par le biais de l’État, le cinéma documentaire arabe, qu’il soit égyptien ou tunisien, syrien ou algérien, marocain ou irakien avait pour mission de matérialiser les directives et réalisations de l’État National Indépendant, d’en montrer la bonne gestion et le respect des délais établis par des plans de développement plus soumis aux contingences politiques qư’aux conjonctures économiques. Les sujets de prédilection étaient “l’électrification de la campagne », « la lutte contre ľanalphabétisme » , « la santé pour tous », « les trésors de la nature », etc.
Alors qu’ailleurs, le cinéma trouvait son existence tant au sein des structures étatiques que de manière parallèle, le cinéma documentaire arabe, à l’instar des pays ex-communistes, s’est d’abord développé dans le giron de l’État et de ses appareils.
Ces États, nouvellement indépendants et fraîchement installés, avaient besoin de légitimité. Le cinéma documentaire était le moyen privilégié non de l’atteindre, mais d’en montrer l’évidence. De ce fait, sa nature étant pervertie, il est devenu impossible de différencier entre l’actualité, la propagande et les plaidoyers pro-domo, les films de vulgarisation de tous genres. Il faut dire, à la décharge de ces États, que le champ social et la mémoire collective recelaient des trésors au bord de la disparition qu’il fallait enregistrer, quitte à tordre le cou à l’histoire en monopolisant la parole. Il valait mieux avoir une image que rien du tout. C’est en ce sens qu’il faut lire la série de films des égyptiens Saad Nadim, Salah El Tohami, lIassan Fouad ou du tunisien Ahmad Ilarzallah, etc.
En Algérie, cette fonction fut la voie majeure du cinéma tant documentaire que de fiction.
Si le cinéma de fiction est, et demeure, la « toison d’or » de tout cinéaste arabe, le cinéma documentaire dans ses différents aspects en est le “rocher de Sisyphe ».
Tout de suite après la défaite de 67, Hassan Fouad, dans un état des lieux du film documentaire arabe, disait : « Dans toute son histoire, le film documentaire égyptien n’a pas eu droit à une production régulière. Il était rare de le voir projeté dans les salles de cinéma, certaines salles demandaient à être rémunérées pour le projeter… Cela parce que ces films étaient entachés de propagande ou de publicité. Cette situation a créé une mauvaise perception du sens du film et de sa fonction sociale et artistique. »
Cette opinion sur le documentaire n’est pas propre à l’Égypte. Tous les cinéastes arabes y souscrivent. Et la constitution de l’Union des Documentaristes Arabes, dont le siège était à Bagdad, n’a pu complètement résorber cette tendance, même si on pouvait remarquer des différences notoires dans l’évolution de ce genre cinématographique dans les pays arabes.
Ainsi le documentaire au Machreq, demeurait-il lié aux soutiens que lui apportaient les pays ex-communistes, tant au niveau des moyens qu’à celui du rayonnement (Festival de
Leipziģ, Karlovy-Vary, etc.) ; il était par ailleurs soumis aux événements du conflit israélo-arabe, et donc à un certain type de directives de l’État. Au Maghreb, il fut moins dépendant des aléas de la politique, et donc plus à même de coller aux réalités du terrain. On peut en donner pour preuve tout le travail opéré par la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA), véritable pépinière qui vit aujourd’hui un état de faillite politique et financière, pour des raisons endogènes qui l’ont fait s’éteindre. Plus proche de la conception latino-américaine de la fonction du cinéma documentaire, cette fédération a donné des oeuvres de grande qualité qui demeurent invisibles, tant au cinéma qu’à la télévision (cette dernière demeure chasse gardée).
Si, comme le remarquait Fawzi Soulayman, « dans le film documentaire, l’intérêt pour les faits culturels est minime face aux courants informationnels ou médiatiques, et Ia production
étatique circonscrite aux seuls films de propagande, la recherche d’une écriture propre au film documentaire s’est cependant affirmée de plus en plus fortement. A cet égard, il faut citer le travail entrepris par le Centre du Film Expérimental — créé en 1968 — et que dirigeait feu Chadi Abdel Salam au Caire. Les films réalisés par Samir Awf ou d’autres jeunes cinéastes, ceux réalisés par Hashem Al-Nahas depuis Al Nil Arzáq ou par Atiyat Al-Abnoudi depuis Hisan al-tin, sont bien des films documentaires, mais qui empiètent sur la fiction.
Au-delà des sujets qu’ils abordent, ils retiennent l’attention du spectateur par une esthétique et une écriture qui portent la marque de leur auteur.
Le travail fait par Al-Nahas sur l’œuvre de Naguib Mahfouz est, à cet égard, très représentatif.
La même tendance existe en Tunisie avec les films de Selma Baccar, Moncef Dhouib, Kalthoum Bournâz, dont les films sont ce qu’on pourrait désigner par des « documents fictionnels » ou des « fictions documentées », tendances déjà inaugurées par le marocain Ahmed Al-Maanouni dans Al-yam Alyam, le libanais Borhane Alaouié dans Il ne suffit pas que Dieu soit avec les pauvres, ou le syrien Omar Amiralay dans La vie quotidienne dans un village syrien.
Le propre de ce genre de films est de briser le cloisonnement entre les genres (thèse défendue par le cinéaste libanais Borhane Alaouié et qu’il a matérialisée dans des films comme Lettres d’un temps de guerre ou Le Haut-Barrage) et, face au retour de la fiction, d’entreprendre de conquérir les écrans du cinéma et de la télévision par cette même fiction « revisitée » pour toucher plus de spectateurs.
Le réel ne sera plus cet enchaînement de faits enregistrés, observés par un entomologiste (ce n’est pas sans raison que “documentaire » se dit en arabe « tasjili » qui équivaudrait à “enregistreur »), mais un réel riche en contradictions, plein de charmes et porteur d’horizons divers. Le seul travers de cette tendance réside dans le fait que le film documentaire est considéré comme un marchepied du film de fiction, comme un leurre pour s’inscrire sur la carte du cinématographe. Ils sont rares, les cinéastes arabes qui font du documentaire un « sacerdoce ».
Khémaïs Khayati