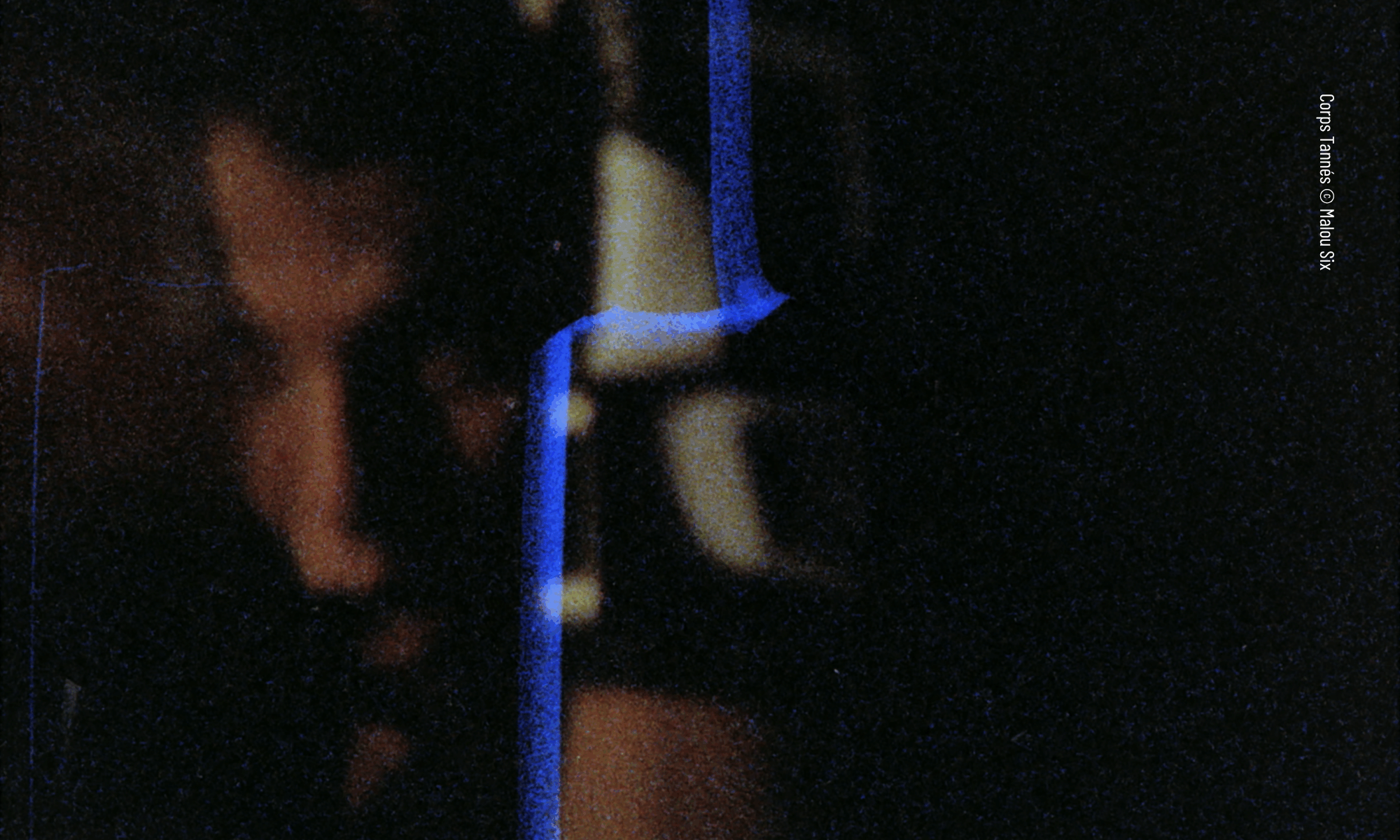À ma si complice compagne…
Une proposition thématique est toujours une aventure si l’on ne se contente pas bien sûr d’en rester à sa simple illustration. Elle se travaille, vous travaille, vous stimule et vous fait douter, vous implique et vous incite à la distance. Une programmation est aussi un acte, un leurre pour soi comme pour l’autre spectateur convoqué. Qu’est-ce en effet que cette prétention à composer une partition, induire un discours, forger des « articulations » arbitraires avec des œuvres, des films qui sont des actes en soi ?
Pour assumer ces paradoxes, il faut en revenir au germe de l’idée, de l’hypothèse avancée…
Un constat courre, même si diversement formulé, à la fois dans les festivals comme dans le discours critique.
Le roman familial, I’autoscopie, la réappropriation créative d’images d’archives intimes privées, prennent une place de plus en plus conséquente dans la « production » documentaire. Il n’y aurait pas en soi de raison majeure de s’y intéresser si l’on veut bien considérer que dès ses origines avec « le déjeuner de bébé des Frères Lumière”, le cinéma a scruté l’intime. Un brin entomologiste, un brin fasciné par ce miroir tendu à la vie en mouvement, ainsi « impressionnée », mais « réactivable ». Longtemps « le cinéma des familles », depuis la Pathé-Baby des années 20, reste cantonné par essence dans la représentation privée, un rite réservé au cercle plus ou moins élargi des « intimes ». C’est aussi durant plusieurs décennies un des systèmes de représentation “d’une certaine classe ». Mais aussi « Un cinéma des pères » : l’icône mouvante, émouvante, idéalisée et codifiée d’un certain état de « bonheur » donné pour la postérité.
Bien sûr l’observateur attentif de ces films aujourd’hui, décèlera dans ce « cinéma des familles” des dissonances, des incongruités, remarquera des absences et tensions perceptibles. Aujourd’hui… car longtemps cet intrus n’avait aucune raison d’en être le spectateur.
Quel est le statut de ces images désormais ? Pourquoi les voit-on ? Pourquoi sortent-elles des malles des greniers? Pourquoi nous procurent-elles souvent l’effet magique et fascinant de scènes primitives ? Parce qu’elles détiendraient une parcelle même infime de reflets de nous-mêmes sur lesquels projeter nos fantasmes et nostalgies… Parce que leur piqué, leur grain, leurs tressautements, leurs flous, leur lumière indécise, la fragilité de leur mise en scène, évoquent de « vraies captures d’instant de vie ». Elles activent et avivent émotions et sentiments, réveillent le désir d’enfant de tout spectateur de cinéma qui aime à se fondre dans l’image. Et qu’on lui raconte des histoires, des contes, des fables. Elles ne peuvent que nous enchanter, comme autant d’instants filmés du pur bonheur : vacances, sourires, voyages, rites perdus, enfances, ripailles, plaisanteries. Elles témoignent d’un temps que nous n’avons pas connu ou qui reste enfoui dans notre mémoire.
En outre, ces images nous promettent la levée du sceau du secret de l’intime. Tels des intrus qui se glissent subrepticement dans Ie cadre. Qui font ainsi « partie » de la famille. Peuvent emprunter un instant celle des autres.
Car ces regards-caméras, souriants, complices ou boudeurs, destinés au filmeur, c’est étonnamment à nous qu’ils s’adressent avec un semblant de véracité, de naturel. Rien en eux n’évoque la mise en scène fictionnelle, un dispositif décidé à nous faire entrer dans le fantasme dans les règles. Tels une œillade de Louise Brooks, une mine langoureuse de Valentino, un regard sombre de Bogart, les lacs bleus de Morgan. « Ce n’est pas du cinéma », ce n’est pas joué, quelque part du réel forcément où cela lui ressemble…
Avec en prime l’illusion d’une certaine « immortalité » octroyée à des instants éphémères qui parviennent à se ressembler de générations en générations.
Ce « cinéma des familles » entre ainsi de plus en plus fréquemment dans le champ de références de notre regard.
Il est l’objet de recherches et de publications telle celle coordonnée par Roger Odin de l’université Paris III (Le « Film de Famille, usage privé, usage public », éditions Méridiens-Klincksieck, 1995). Il donne lieu à des « Fêtes du film de famille » comme en organise Saugnac-Muret dans les Landes, l’architecte-urbaniste Michel Cantal-Dupart.
Il s’immisce avec bonheur dans des séries patrimoniales destinées à faire revivre la mémoire des régions et des vieux métiers (série « Mémoires de » — Bretagne, Marseille, etc — des Editions Montparnasse). Ou pour évoquer les « Jours d’été », beau film de montage de Françoise Bernard, Ariane Doublet, Juliette Cahen et Pascal Goblot.
Il est collecté par les cinémathèques régionales, « transféré » en vidéo par les familles pour être regardé sur le téléviseur. Et…
De plus en plus « emprunté » par les artistes et documentaristes. Certains, tel Claude Bossion, commencent par récupérer de vieilles bobines dans brocantes et greniers et les font tourner en boucle dans une « installation » reproduisant un salon bourgeois d’antan (Fondation Cartier, au printemps 1996). Avant de systématiser sa recherche avec « Mémoire d’Outremer — Ie cinéma des familles » pour tenter de rapprocher les cultures et faire redécouvrir le creuset marseillais à travers la convocation croisée des archives (au château d’If cet automne). D’autres, comme Peter Forgacs reconstitue par bribes, la métamorphose des lieux et de la société hongroise à travers la série « Hongrie privée” à partir de films réalisés dans la sphère intime.
Le hasard peut aussi initier une dramaturgie et un suspense comme dans la quête-enquête entreprise par Henri-François Imbert pour « Sur la Plage de Belfast », trois minutes d’un film amateur retrouvé dans une caméra achetée d’occasion. Qui incite le cinéaste à partir à la recherche de ces visages, de ces regards rencontrés.
Le monde se partage aussi (et se partagera de plus en plus à l’ère caméscope) entre ceux qui ont été filmés un jour par un proche, un parent, un intime et ceux dont il ne reste pas “d’image”.
Ce que celles-ci disent de “l’être au monde », “d’être né là quelque part dans cette famille là”, dans cet instant qui appartient plus largement à « l’Histoire ». Une génération de documentaristes souvent « trentenaires » semble taraudée aujourd’hui par le désir d’interroger
cette empreinte, ces traces. Pour retisser les fils de la mémoire, des non-dits, des secrets, interroger les tabous, les souffrances ou les nostalgies.
Et nous embarquer ainsi, nous spectateurs, avec plus ou moins de proximité ou de distance dans ce voyage à travers le miroir des apparences. Qui peuvent être parfois les nôtres
On en retrouvera beaucoup d’exemples à chaque fois singuliers dans leur traitement comme dans leur processus de création. Tant dans la programmation… qu’en compétition (sélectionnés ou visibles à la carte). Ce qui prouve |’actualité évidente de cette utilisation de “l’album de famille » pour répondre au désir de mémoire, d’identité, de représentations de l’Histoire.
À cette quête introspective sous le signe de la réminiscence interrogée, répond dans une étrange balance, celle de la vidéo-miroir, forme d’auto-surveillance de l’intime. Voici le caméscope (ou la caméra super 8, mais c’est encore du temps cinéma avec des bobines de 3mn à développer) convoqué pour enregistrer « en temps direct » la pensée, le sens à trouver, la relation, la rencontre. Pour remplacer le confesseur, faire preuve du communicable ou de l’incommunicable ; voire servir de médiateur, pour dire, révéler, poser les questions longtemps refoulées. Pour reconstituer le théâtre de la vie à l’instar d’un Alain Cavalier avec « La Rencontre » ou d’une Sophie Calle avec “No sex last night ». Des films que nous aurions aimé montrer aussi, même si la « Famille » ici se resserre sur le couple, le duo.
Les formes de cette investigation de l’intime diffèrent, tant dans leur dispositif de mise à distance que dans leur recevabilité comme « acte cinématographique ». Donc comme espace de représentation que le spectateur peut s’approprier ou non. Sur lequel il peut transférer ses affects, sa compassion, son empathie, ses résonances.
Car ce qui, dans le cadre traditionnel littéraire du « Journal intime », lui est chuchoté, murmuré ou clamé avec véhémence, reste en général par règle implicite, du différé, adouci par le temps, le contrôle, la maîtrise du dit et du non-dit. Un « verrouillage », une « censure », une délégation à la postérité, maintes fois enfreinte pourtant… par André Gide, Michel Leiris, Jean Genêt, Hervé Guibert…
Mais qui jamais n’atteint toutefois l’effet de loupe de l’affichage spéculaire. Les silhouettes, les ombres figées dans le tombeau des mots dansent ici la sarabande plein écran au fond de la caverne de notre conscience du monde.
Le sujet, le distinct, le singulier, l’individu, s’affirme (ici, car ce n’est pas universel loin s’en faut). Mais cette conquête de l’intime lui révèle plus que jamais l’humaine solitude malgré les faux-semblants, les codes, rites et tabous comme autant d’artifices protecteurs.
Le médium télévision (quelle que soit la forme du meuble, téloche des familles ou écran à plasma, sa technologie ou son mode de diffusion) engage le spectateur dans la « proximité du même”. Où qu’il soit. Avec l’instantanéité du « direct », cérémonie comme catastrophe, carnage comme faits-divers, témoignage ou opinion micro-trottoir — sans nécessairement la sincérité. Avec des programmes, kaléidoscope du monde, sans nécessairement les effets de sens stimulant son intelligence. “Une grande famille planétaire » vibrant aux mêmes jeux du cirque, faisant forum cathodique, sortant les mouchoirs pour les mêmes célébrations. Pourtant qui pourra évaluer comme nos regards sont usés, nos capacités d’émotion émoussées, car nous avons, à voir et à entendre tant de choses. La fillette d’Armerio qui se noie en direct et l’indice CAC 40 quotidien, le énième SDF convoqué pour témoigner de la galère des hivers dans Lutèce et la météo du lendemain, le énième sans-papier contraint à dire Nous, pour se faire entendre tandis que se prépare la prochaine Coupe du monde de foot. Des guerres « chirurgicales » avec des images à la place des images. Et le millefeuilles des couches de “plus jamais ça » qui s’empilent benoîtement, de génocides et massacres en « purification ethnique ».
Toutes choses censées nous permettre d’atteindre certains degrés de conscience, susciter compassion ou engagement.
Mais qui nous laissent d’abord spectateur, absent de soi et fondu dans l’image. Remués dans nos affects ou nos opinions, mais d’abord pantois tant que la télécommande n’a pas appuyé sur Ia touche stop.
Le « cinéma des familles » était sans doute une manière conventionnelle et à beaucoup d’égards artificielle de « symboliser » un « tous ensemble » et une « représentation du bonheur », un peu mièvre et doucereuse mais d’un suranné qui nous réjouit et stimule l’imagination. Bien éloigné du « Tous ensemble » qui appelle à lutter et revendiquer pour des projets, des avenirs. Mais aussi de celui proposé par le modèle télévisuel qui de Psy-Show en « ça se discute », invite à baisser les masques voire dans une version actualisée chercher chacun son chat dans une même cour d’immeuble si conviviale ma foi. Tous pareils, tous différents. Une communauté de distincts mais une communauté devant l’écran…
Parallèlement, l’évolution technologique a constamment rapproché la focale sur le « réel » pour le meilleur et le pire.
Dans les années soixante, la caméra 16 mm synchrone puis les portables vidéos ont permis l’émergence des cinémas « vérité », « direct” ou du « réel ». En prise « avec la vie telle qu’elle est », telle qu’elle se donne à voir du moins devant l’objectif. Selon le dispositif élaboré, la mise en scène proposée. Question de forme, question de point de vue.
Avec la vidéo légère, ce rapprochement spéculaire de l’être, de l’intime, ce « ciné-œil » ne fait qu’amplifier la surveillance, son effet de miroir instantané. Grand large, grand écran, de sa petite fenêtre la télévision prétend nous donner à voir tout le spectacle du monde. A coup de steady-cam, de travelling et de Louma, selon les points de vue les plus insensés, les plus impossibles à vivre. Sur la commode de la chambre à coucher, ou posé sur le grille-pain même si ce n’est pas conseillé, le caméscope peut enregistrer et donner à voir l’image de beaucoup d’amour, d’une crise dominant-dominé, des larme de pluie derrière une fenêtre qui suinte un triste automne, une solitude ou une fête. Mon beau miroir, que me dis-tu, que me veux-tu ? Garde la trace magnétique ou numérisée d’un instant choisi, d’un instant complice, d’un instant volé. Pas nécessairement indélébile avant l’hypothèse DVD.
Qui peut, quand on veut, reproduite, arrêtée sur image, accélérée ou retardée pour une “consommation du regard immédiate » individuelle ou collective, rejoindre la trappe du magnétoscope. Et produire le sens que l’on veut, question montage, avec l’actualité, un sitcom, ou un thriller… Étrange cocktail.
Mais cette ère-caméscope, et de l’écran envahisseur, filtrant toujours un peu plus nos perceptions du monde, est aussi celle du besoin de racines, du désir d’investigation de la mémoire. Avec ces nécessaires croisements et passages entre l’intime et le collectif, entre le
roman privé et l’histoire. Avec des frontières qui se brouillent, des limites et des tabous qui se diluent voire se brisent.
C’est en quoi un film comme « Demain et encore Demain » de Dominique Cabrera est un film important. Un film fragile car il doit être, bien vu, bien entendu. Qu’il se mérite, car il réclame l’ouverture de l’esprit, des sentiments comme des sens et ne supporte pas les préjugés rassis. Ainsi, nous avons grand plaisir à le montrer, « l’exposer » dans ce contexte là.
Ciné ou vidéo journal, investigation du je et de la relation à l’autre peuvent s’envisager comme des reconquêtes, des réappropriations de temps et de cette conscience de soi, seuls garants de la conscience d’autrui.
Des démarches documentaires peuvent s’approcher du secret, de la fêlure, du doute, de l’incommunicable. Elles ne peuvent jamais être indignes quand elles manifestent et témoignent d’une présence quand elles permettent la maïeutique d’une parole, qu’elles rendent au réel sa complexité. Ainsi de « Best Boy » ou de « On the Waves of the Adriatic » pour ne citer qu’eux. Ils sont la fleur de sel du cinéma. Ce sont des films que nous aimons. Ce sont des films qui sont dans cette programmation.
Didier Husson
Films
À la recherche de Vera Bardos
Danielle Jaeggi | 1995 | 17'
« Le jour où j’ai réalisé que je ne savais pas le nom de ma tante, morte à quinze ans en camp de concentration, j’ai été saisie d’effroi. Ceci est un film sur la mémoire qui revient, sur l’impossible oubli. »
Asmara
Paolo Poloni | 1993 | 76' | Suisse, Allemagne
Un fils, un père. Une mémoire à trous et caches. Un voyage à deux pour la réactiver, la soumettre à la question. Pour tenter de comprendre, de se comprendre aussi sans doute… « Je me souviens des dimanches froids et gris où toute ma famille se réunissait autour de l’album de photos. Pendant ce temps, la vie du petit village suisse s’écoulait lentement. Parmi les innombrables photos de vacances en Italie, notre pays d’origine, l’une m’attirait de manière inquiétante, sinistre. On y voyait six personnes pendues. C’étaient des noirs aux longs vêtements blancs. On distinguait la corde autour de leur cou. La photo resta gravée dans ma mémoire… et je grandis. Peu à peu, le mystère de cette image se révéla : mon père avait participé comme soldat à la guerre d’Éthiopie en 1936. Ensuite il vécut quinze ans à Asmara, la capitale de la colonie italienne d’Érythrée, avant de rentrer en Italie puis d’émigrer en Suisse. Je n’ai jamais rien su de cette longue période. On n’en parlait pas. C’était une période tabou pour nous comme d’ailleurs pour tous les italiens. Un jour, je décidais de tourner un film autour de ces deux tabous, le privé et l’historique. »
Best Boy
Ira Wohl | 1979 | 104' | États-Unis
Ira Wohl filme son cousin Phil, handicapé mental adulte, qui jusqu’à ses cinquante-deux ans, a été complètement protégé du monde par ses parents. Une caméra témoin mais aussi participative qui accompagne le processus d’ouverture d’une chrysalide durant plus de trois ans. Si Best Boy est l’histoire d’une « émancipation » et d’une découverte du monde, tous les acteurs du cercle familial évoluent avec lui…
Ira Wohl a commencé sa carrière de cinéaste au début des années soixante-dix en tant qu’assistant sur le film d’Orson Welles Don Quichotte avant de travailler en télévision et de réaliser plusieurs courts et longs métrages documentaires. Depuis 1990, Ira Wohl est devenu psychothérapeute et réalise des séries documentaires sur les diagnostics psychologiques.
Il réalisera ensuite Best Man : Best Boy et chacun d’entre nous vingt ans après, puis Best Sister.
Chargée de famille
| 1995 | 83'
« Avoir une famille, c’est une expérience humaine universelle. Même les orphelins savent ce qui leur manque, mesurent le vide de ce qu’ils n’ont pas connu ou perdu trop vite. Qu’est-ce que transmet une famille ? À quoi sert-elle ? Comment pèse-t-elle ?
À travers quatre générations d’hommes et de femmes d’une même famille, par l’addition de portraits successifs entrecoupés d’archives familiales 8 mm et Super 8, j’ai cherché à reconstruire le puzzle d’une famille et approcher cette notion aux mille définitions du dictionnaire.
Comment peut-on être à la fois et aspirer à être “un”, indivisible et faire partir d’un tout auquel on se raccroche et qui est sa famille ? Chargée de famille se veut être cette approche à la fois générale et générique en même temps qu’une démarche très personnelle puisqu’il se trouve que c’est “ma” famille que j’ai choisie de filmer. »

Chère Grand-mère
Patrice Dubosc | 1995 | 18' | France
Des films 8 mm tournés par une mère disparue, une grand-mère polonaise inconnue, un « voyage de retour », une femme aimée : des fragments à partir desquels il s’agit, pour le héros, de renouer les fils rompus de la vie.

Family Viewing (Visionnage en famille)
Atom Egoyan | 1987 | 82'
C’est l’un des premiers films de l’auteur de De beaux lendemains, prix du jury à Cannes cette année et sur les écrans depuis octobre. Issu d’une famille arménienne installée à Toronto, Atom Egoyan n’a cessé depuis ses premiers films au début des années quatre-vingt, d’installer dans ses scenarii, un principe de mise en abîme des images où télévision et vidéo (familiale, de surveillance) fabriquent mémoires et effets de miroir. Réfléchissant traumatismes, fantasmes pervers ou nostalgies bienheureuses. Mais Family Viewing est en sus une fable moderne : sur le primat du télévisuel et de l’irréalité « écranique », tyrannique, absorbante au sens littéralement physique du terme. Sur la désagrégation (mais aussi la possible recomposition imaginaire) de la cellule familiale nucléaire. C’est encore l’inventaire du mensonge et du faux-semblant, de l’hypocrisie et de l’enfermement quasi mutique, régissant nombre de relations humaines. Et en prime un regard sur la vieillesse et la manière dont elle est considérée. Mais dans cet apparent processus d’accablement, Egoyan nous ménage des points de fuite dans ces impasses.
Free Fall (Az Örvény’ / Chute libre)
Peter Forgacs | 1996 | 75'
Peter Forgacs a entrepris depuis 1989 l’exploration de la mémoire collective hongroise à partir d’archives cinématographiques privées. Il donne à celle-ci une traduction originale avec la série Hongrie Privée, un véritable « feuilleton vidéo » retraçant à partir de « films de famille » des destinées individuelles. Dixième opus de cette série, Free Fall, prend la forme d’un opéra-vidéo composé sur une musique originale de Tibor Szemzö à partir des images privées de György Peto filmant sa famille entre 1938 et mars 1944.
Au printemps 1944, toutes les communautés juives de l’Europe occupée par les nazis sont emportées dans le maelström. Malgré l’édiction de lois antisémites en Hongrie depuis 1938, la communauté juive hongroise n’est pas encore touchée… Comment cela a-t-il été possible ? Comment ont-ils été emportés dans la tourmente nazie ? Vue de l’intérieur, quelle était la vie de ces « futures victimes » dans cette étouffante atmosphère ? Quelle compréhension peut-on avoir du langage brutal de la loi si elle vous est soufflée à l’oreille par des voix angéliques ? Malgré le rétrécissement de l’espace vital et les signes de plus en plus effrayants d’une réalité, pourquoi subsiste jusqu’à la fin l’espoir… ?
Peter Forgacs est né en 1950 à Budapest. Après des études de sculpture et de graphisme, il est entré aux studios Bela Balazs en 1978. Il pratique la photo, réalise des films expérimentaux et, pour la télévision hongroise, des fictions documentaires. Peter Forgacs séjourne deux ans en Angleterre et commence la série Hongrie Privée en 1989. Les quatre premiers épisodes sont présentés au cours de « Parcours du Double, ethnologie de l’imaginaire » une manifestation organisée par Pierre Ponant et Arts Rencontres Internationales au Musée National des Monuments Français au Palais de Chaillot « Wittgenstein-Tractatus, le Dictionnaire Bourgeois » est présenté à Gentilly il y a trois ans dans le thème, « Les territoires de la mémoire ».
Tibor Szemzö a suivi des études musicales au Conservatoire Bartok, à l’Académie Franz Liszt et à la Schola Hungarica. Il joue des musiques improvisées avec son propre quatuor dès 1970 et a créé au début des années quatre-vingt, le groupe 180, Ensemble de musique nouvelle. Il s’est engagé dans un courant utilisant « l’électronique primitive », des instruments expérimentaux, des voix et éléments verbaux. Compositeur et interprète, il se produit en concert et lors de performances. Invité à Parcours du Double, manifestation citée plus haut.
Héritages
Daniel et Pascal Cling | 1996 | 52'
Ce qui est dit, ce qui est tu. Ce qui fait souffrance pour les uns, pour les autres. Ce qui se transmet. Et le temps qu’il faut pour le dire. Trois générations face au travail de mémoire. Intensité et pudeur… Trois rescapés d’Auschwitz racontent de quelle façon et dans quelles circonstances, ils ont révélé leur histoire depuis leur retour. Leurs descendants expriment ce qu’ils ont ressenti en la découvrant, en quoi elle a marqué leur identité et ce dont ils se sentent investis. Ainsi se constitue un récit complexe, quelquefois contradictoire, qui met en lumière les effets de la parole et des non-dits sur trois générations et plus généralement soulève la question de la transmission de l’histoire.
Joe et Maxi
Maxi Cohen et Joël Gold | 1978 | 80'
« Faire le film, c’était voir mon père, c’était me voir moi-même » déclare à la fin de Joe et Maxi, la jeune réalisatrice (vingt-trois ans à l’époque) Maxi Cohen. Comprendre un père et le regard qu’il porte sur vous. Se comprendre. Ce « rêve de film » remontait dix ans en arrière quand Maxi Cohen imaginait faire le portrait d’un « héros énigmatique », aventureux, candide et charismatique. Deux événements décideront de l’accomplissement de son projet : la mort prématurée de sa mère atteinte d’un cancer et la rencontre d’un complice, Joël Gold permettant d’envisager ce portrait. Mais si intimement lié à la vie, le film tourne au journal de bord d’une rencontre et de la maladie…
Jours d’été
Françoise Bernard, Juliette Cahen, Ariane Doublet et Pascal Goblot | 1997 | 52'
Dans le même esprit et le même principe du montage de films amateurs que leur précédent film Terre Neuvas (avec Manuela Fresil en plus dans l’équipe)…Les auteu·rices évoquent cette fois un demi-siècle de congés payés. Une douce balade entre fête villageoise et bord de mer, entre farniente et randonnées. Avec des madeleines d’enfance, des romances adolescentes. Une partition savamment articulée, pour fusionner après un long travail de collecte – une myriade de mémoires intimes qui peuvent ainsi rencontrer notre imaginaire collectif.
Le Kougelhopf
Ginette Lavigne | 1993 | 12'
« J’ai filmé ma mère en train de confectionner un kougelhopf, gâteau traditionnel de Transylvanie. Elle pétrit la pâte, et remue ses souvenirs : la vie d’une femme juive en Roumanie, l’exil, l’histoire de sa famille disparue dans les camps nazis. »
Les Lapirov passent à l’ouest
Jean-Luc Léon | 1994 | 90'
En mai 1981, une famille juive soviétique quitte l’URSS pour les États-Unis, emportant quantité de valises au contenu hétéroclite. De Moscou à Los Angeles, en passant par Vienne et par Rome, Jean-Luc Léon a filmé la chronique souvent cocasse de la découverte de l’Occident par cette famille, d’émerveillements en petits désenchantements jusqu’à l’installation définitive. Dix ans plus tard, le cinéaste retrouve trois citoyens américains : après la chute du mur, Isabelle et Ilya Lapirov, et leur fils Innokenti devenu Ken retournent pour la première fois en vacances à Moscou…

Lili m’a dit
Joël Bartoloméo | 1997 | 17'
Mes Vidéos 91-95
Joël Bartoloméo | 1995 | 80'
- Série : À quatre ans, je dessinais comme Picasso (1991)
- Film de famille, 3′
- Tout le monde meurt, 2’26
- Souvenir rêvé, 1’22
- Série : Petites scènes de la vie ordinaire I (1992-1993)
- Le jeudi de l’Ascension, 1’52
- Papa gros con, 1’25
- Filme ma poupée,1’41
- La vache qui parle, 5’19
- Série : Les grands moments de la photo de famille (1992-1993)
- Famille B, 4’26
- Maintenant, 1’05
- Épilogue, 50”
- Série : Petites scènes de la vie ordinaire II (1994-1995)
- La tarte au citron, 4’23
- La forêt de Rambouillet, 2′
- Les joujoux de Noël, 5’34
La Vision théorique
« … Du plan serré au plan large, du cinéma primitif (L’Arroseur arrosé) avec ses séries de plan-séquence autonomes. Aux mises en scène avec personnage pour lesquelles il conçoit à chaque fois des micro-scénarios. Un cadrage et un montage. On peut voir se dessiner une forme linéaire qui vise, sur la base des mêmes éléments, un vocabulaire structuré de la relation à l’autre, avec tout ce que cela implique de rapport de force ou de séduction. Ce qui demeure tout au long de ce parcours demeure l’ambiguïté et la tension de la position de l’artiste Bord-Cadre, entre absence et présence. En y ajoutant de l’intérieur, de nouveaux syntagmes, Joël Bartoloméo s’applique à élargir un corpus initialement restreint, à le desserrer de son emprise avec le genre, de la photo de famille au cinéma amateur. », Stéphanie Moisdon-Trembley, présentation de l’édition vidéo
La Vision « People »
« Volubile, passionnée et adepte des équations insensées, voici Lili, belle comme une héroïne de Woody Allen. Timide, rire de ventriloque et lunettes-bicyclette, tout droit sorti d’une comédie de Jacques Tati, voilà Joël, son mari. Nom de couple, les Bartoloméo, tous deux nés à Bonneville (Haute-Savoie), dans la même maternité, accouchés par la même sage-femme, elle en 1956, lui, un an plus tard. C’est lui, l’artiste, lui qui depuis dix ans filme en vidéo et presque en huis clos leur vie quotidienne avec les jumeaux, Coline et Fabian, onze ans et bien sûr Lili. » En fait, précise Joël Bartoloméo ce sont des films de famille anti famille qu’il a commencé sans vraiment savoir ce qu’il allait en faire, absorbé par cette caméra qui est devenue un outil à enregistrer les rites et rituels de sa petite tribu, Toujours prête à entrer en action. « Un chien » ajoute Lili.
Portrait par Brigitte Ollier, série Duos intimes (Libération, 19 août 1997).
La Vision des « Écrans Documentaires »
Au-delà de l’originalité du dispositif artistique posé par Joël Bartoloméo, ses travaux vidéos interrogent les perspectives du « cinéma des familles » à l’ère caméscope. Contiguïté et détournement, décalage et subversion, effet de loupe sur l’intime… Des films à priori sans visée « documentaire ». Comme semblerait l’attester d’ailleurs le circuit artistique dans lequel ils sont diffusés : Semaine internationale de la vidéo de Genève, Centre Georges Pompidou, Espace Croisé de Lille, etc. Pourtant la porosité des « genres », des actes, tels qu’ils sont par habitude dûment étiquetés en est d’autant plus questionnée. En fonction du contexte de diffusion, la maîtrise d’une œuvre échappe-t-elle à son auteur ? De quel point de vue la découvre-t-on et dans quelle perspective ? Qu’est-ce qui fait l’acte artistique et sa reconnaissance ? Les Archives Bartoloméo deviendront-elles documentaires ?
Osaka Story
Toichi Nakata | 1994 | 75' | Grande-Bretagne, Japon
Malgré une mise à distance volontaire dans son exil anglais, son immersion dans une autre culture et d’autres modes relationnels, le réalisateur éprouve le besoin du Retour pour solder ses doutes et faire le point… Un film pour éloigner de ces questionnements et un miroir aussi, pour les membres de sa famille.
Après quelques années à l’étranger, Toichi, le réalisateur retourne dans sa ville natale d’Osaka pour filmer les siens. Dans les mille et un détails de la vie quotidienne vont se révéler les fractures visibles et les problèmes plus secrets de cette famille prise entre deux cultures, la japonaise et la coréenne, dont les relations ont toujours été difficiles. Le père entretient une autre famille en Corée, la mère se pose des questions sur son présent et son avenir. Le frère est pris entre ses affaires dans l’entreprise paternelle et la secte dont il est adepte. Une des sœurs a fait ses choix et assume son indépendance. Quant à Toichi, son dilemme n’est pas moindre : doit-il pour de bon rentrer au Japon et jouer le rôle traditionnellement dévolu à l’aîné des fils ? Ou peut-il retourner en Occident, et assumer seul ses choix de vie ?
Quand j’étais petit, le Liban pour moi c’était ça
Stéphane Olry | 1997 | 18'
Par l’auteur (avec Corine Miret) des cartes postales vidéos du « Voyage en Orient ». Un film de (par, pour la) famille et pour soi à travers elle. Un voyage comme une « lettre au père » qui musarde dans la mémoire et les clichés de l’Orient. Et une tentative de décryptage de certaines des représentations imaginaires que nous en avons.

La Quatrième génération
François Caillat | 1997 | 80'
L’histoire d’une famille mosellane liée au commerce du bois : son ascension et son déclin, de 1870 à nos jours. Cette saga familiale est emblématique parce qu’elle reflète l’aventure d’une région et les aléas de sa prospérité. Elle révèle aussi une étrange destinée nationale : celle de tous les lorrains qui, en un siècle ont vécu cinq fois écartelés entre leur identité française et leur annexion à l’Allemagne. La quatrième génération – à laquelle appartient le réalisateur – est celle qui vient « après », lorsque tout est joué, et qu’il ne reste que le souvenir.
Sur les flots bleus de I’Adriatique (On the waves of the Adriatic)
Brian McKenzie | 1990 | 120'
Une chronique familiale à huis clos. La maison qui tient lieu de refuge aux membres de la famille est dirigée avec une autorité distante par le père de Graeme, Steven, slovène qui a émigré en Australie à la fin de la seconde guerre mondiale. Graeme et ses deux amis Stephen et Harold, ne sont jamais parvenus à travailler et passent leur temps à récupérer des pièces détachées de véhicules. Pour eux comme pour le reste de la maisonnée, le plus beau des rêves serait de pouvoir conduire une voiture alors même que tous ne savent ni lire ni écrire. Brian McKenzie les rencontre dans une bibliothèque municipale où ils tuent leur ennui…
« J’ai découvert ce film en Australie en septembre 1990 à un moment où nous n’étions pas encore envahis par la médiatisation de la “fracture sociale” et peut-être aujourd’hui ce film aurait-il suscité davantage d’intérêt en France. Pour l’anecdote mais ô combien significative, je venais d’arriver. C’était le premier film que je devais visionner. J’étais encore très peu familiarisée avec l’accent australien, encore moins avec celui, plus difficile, des protagonistes du film, je comprenais un mot sur deux. Je suis restée fascinée pendant deux heures. Et c’est bien la magie du film qui procède de la proximité des personnages et de la complicité qui s’est établie entre Brian le cinéaste, Graeme et ses compères. C’est un film qui ne s’apitoie pas. Par la générosité du réalisateur, ce film d’une chronique familiale anodine permet aux personnages de réacquérir la dignité et d’exister avec leurs émois, leurs peines et leurs rêves, même dérisoires. », Suzette Glenadel, déléguée générale de Cinéma du Réel
« Si dans les prochaines années, il doit exister un nouveau cinéma, c’est dans un film comme l’australien On the waves of the Adriatic qu’on en voit les prémices. ll correspond à la définition du genre documentaire mais c’est avant tout un film surprenant et beau devant lequel on se demande souvent comment le réalisateur a pu obtenir cette scène ou cette autre… Les personnages m’ont fait penser aux romans de Steinbeck : des gens qui n’ont que le minimum pour subsister mais qui entretiennent une relation amoureuse avec la vie… », Abbas Kiarostami, auteur de Close-up, Où est la maison de mon ami ?, Au travers des oliviers, membre du jury de Cinéma du Réel 1991. In Libération 19 mars 1991.
Séances
jeudi 30 octobre 1997 à 19h00
Vidéothèque de Paris
Plus d'informations sur cette séanceOuverture du cycle Histoires de Famille. Débat sur les représentations de mémoire intime et collective avec les réalisateur·rices, à l'issue des projections .
- Chère Grand-mère
Patrice Dubosc | 1995 | 18’ | France - Le Kougelhopf
Ginette Lavigne | 1993 | 12’ - À la recherche de Vera Bardos
Danielle Jaeggi | 1995 | 17’
jeudi 30 octobre 1997 à 21h00
Vidéothèque de Paris
Première à Paris. En présence du réalisateur.
- Free Fall (Az Örvény’ / Chute libre)
Peter Forgacs | 1996 | 75’
mercredi 5 novembre 1997 à 20h00
Campus Jussieu, Amphithéâtre 24
Plus d'informations sur cette séance- Family Viewing (Visionnage en famille)
Atom Egoyan | 1987 | 82’ - Les Lapirov passent à l’ouest
Jean-Luc Léon | 1994 | 90’
vendredi 7 novembre 1997 à 14h00
Grande salle Hôtel de Ville de Gentilly
Plus d'informations sur cette séanceProjection suivie d'un débat avec les auteur·rices et Pierre Ramognino, journaliste à Téléscope.
- Jours d’été
Françoise Bernard, Juliette Cahen, Ariane Doublet et Pascal Goblot | 1997 | 52’
vendredi 7 novembre 1997 à 20h00
Grande salle Hôtel de Ville de Gentilly
Plus d'informations sur cette séanceSur les flots bleus de l'Adriatique, présenté par Suzette Glenadel, déléguée générale de Cinéma du Réel.
- Best Boy
Ira Wohl | 1979 | 104’ | États-Unis - Sur les flots bleus de I’Adriatique (On the waves of the Adriatic)
Brian McKenzie | 1990 | 120’
samedi 8 novembre 1997 à 14h00
Grande salle Hôtel de Ville de Gentilly
Plus d'informations sur cette séance- Quand j’étais petit, le Liban pour moi c’était ça
Stéphane Olry | 1997 | 18’ - Asmara
Paolo Poloni | 1993 | 76’ | Suisse, Allemagne - Héritages
Daniel et Pascal Cling | 1996 | 52’
samedi 8 novembre 1997 à 16h00
École Henri Barbusse
Plus d'informations sur cette séanceHistoire de famille à voir en famille
samedi 8 novembre 1997 à 20h00
Grande salle Hôtel de Ville de Gentilly
Plus d'informations sur cette séance- Osaka Story
Toichi Nakata | 1994 | 75’ | Grande-Bretagne, Japon - Joe et Maxi
Maxi Cohen et Joël Gold | 1978 | 80’ - Mes Vidéos 91-95
Joël Bartoloméo | 1995 | 80’ - Lili m’a dit
Joël Bartoloméo | 1997 | 17’
dimanche 9 novembre 1997 à 14h00
Grande salle Hôtel de Ville de Gentilly
Plus d'informations sur cette séance- La Quatrième génération
François Caillat | 1997 | 80’ - Chargée de famille
| 1995 | 83’